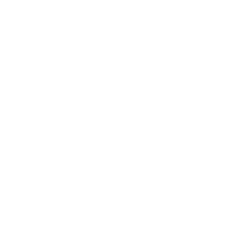Inventorier le vivant et le rendre accessible
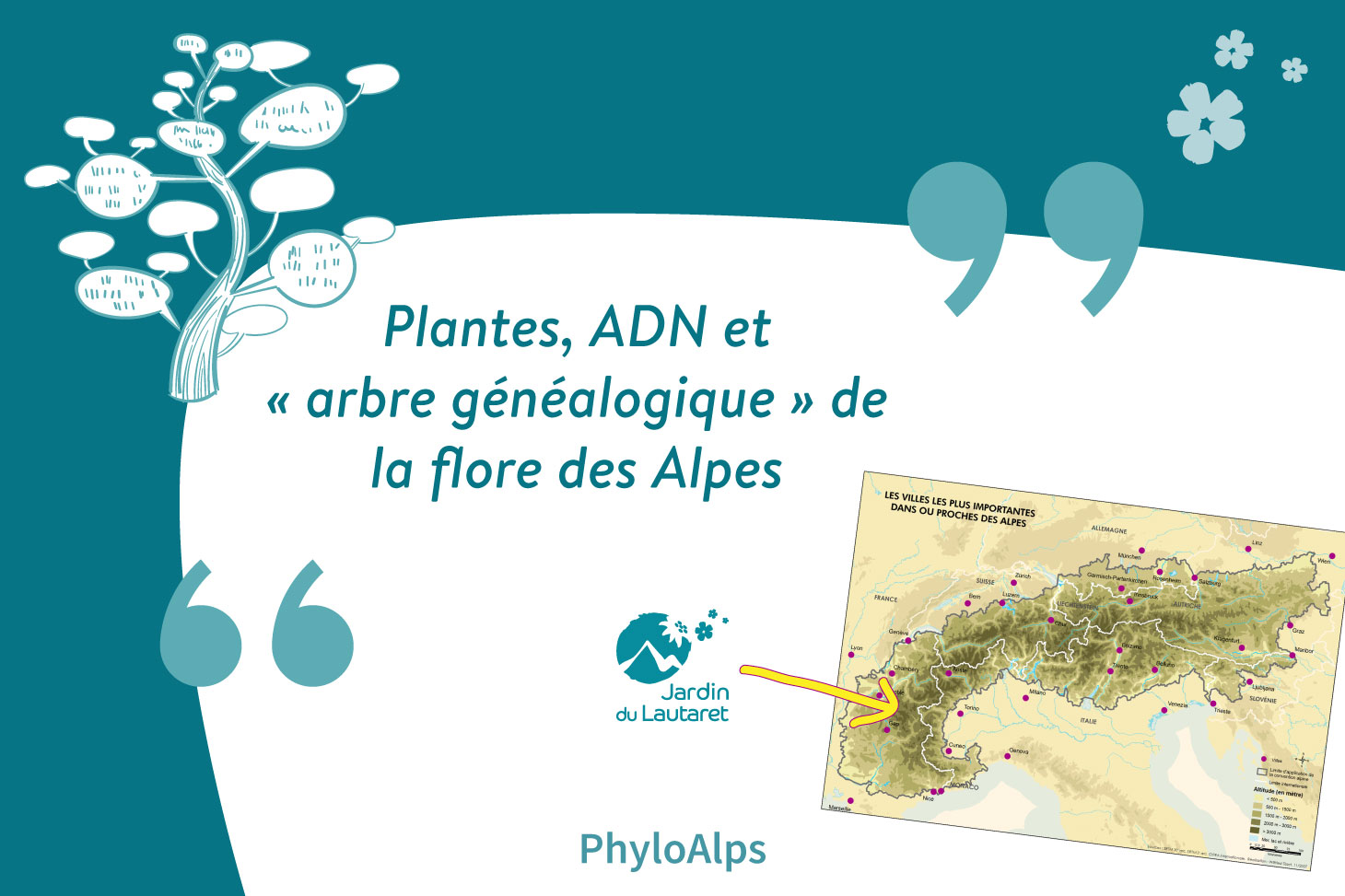
Le jardin du Lautaret est un lieu pour faire « connaissance », au sens propre comme au figuré !
Grâce à de premiers échantillonnages réalisés avec Pierre Taberlet, pionnier du barcoding environnemental (une méthode permettant d’identifier les espèces via leur ADN laissé dans l’environnement), une question surgit :
Et si on séquençait l’ADN de toute la flore de l’Arc Alpin pour comprendre comment elle s’y est installée et comment elle a évolué au fil du temps ?
En 2010, c’est une armée de botanistes Français, Suisses, Allemands, Autrichiens, Italiens qui se partagent d’Est en Ouest les 1 200 km de l’Arc Alpin. Le projet prend de l’ampleur… et les défis logistiques aussi.
Un défi de taille : le séquençage
Avec des milliers d’échantillons à traiter, impossible de tout séquencer en interne à Grenoble. Il faut externaliser. Un premier lot part en Chine… mais la collaboration est difficile. Un appel à projets est lancé par France Génomique pour financer des approches de séquençage massif de la biodiversité. Un partenariat est monté avec le Genoscope français et le projet PhyloAlps est accepté en 2013. Les 1er essais de séquençage commencent en 2014. Et le gros du travail s’effectue entre 2015 et 2020.
De l’ADN aux données exploitables
Le séquençage terminé, reste à transformer ces millions de fragments d’ADN en données utilisables. Au Laboratoire d’écologie alpine, des mois et des années de travail méticuleux commencent pour organiser et analyser les séquences pour pouvoir comparer les espèces entre-elles. Dès 2016, les premières publications scientifiques sortent.
Préserver la mémoire du vivant
Parce que les scientifiques sont des gens consciencieux, chaque prélèvement ADN est doublé d’une part d’herbier, preuve de l’identité des échantillons. Résultat des heures et des heures de travail au jardin du Lautaret : 5 000 spécimens, soigneusement conservés dans notre herbier (acronyme GR). Un herbier physique indispensable à la recherche, c’est bien. Un herbier numérique, accessible à tous, c’est mieux.
Numériser l’herbier : un parcours semé d’embûches
Dès 2018, la numérisation des échantillons apparaît nécessaire. En 2022, nous obtenons enfin un budget pour nous appareiller. Mais voilà… Le prestataire nous vend, à notre insu, une machine défectueuse déjà renvoyée en SAV par son précédent propriétaire... On rebondit en 2024 en sollicitant l’Inist qui se lance dans la R&D pour développer une solution adaptée. L’équipe du jardin rentrent tout juste de Vandœuvre-lès-Nancy pour ramener les boîtes d’herbier à Grenoble.
Et maintenant ?
Prochaine étape : la mise en ligne sur e-ReColNat, le grand projet de numérisation des collections naturalistes françaises, piloté par le Muséum national d’Histoire naturelle.
L’arbre généalogique ne cesse de s’enrichir et a inspiré de nombreux autres consortium : PhyloNorway, PhyloPyrenees, PhyloCarpathians.
Mis à jour le 19 février 2025
Nature Communication
Pour ceux que ça intéresse, 2 papiers sont déjà publiés dans Nature. 1 vient d’être accepté et 1 autre est en attente de validation. Sans compter le reste des publications du consortium PhyloAlps.